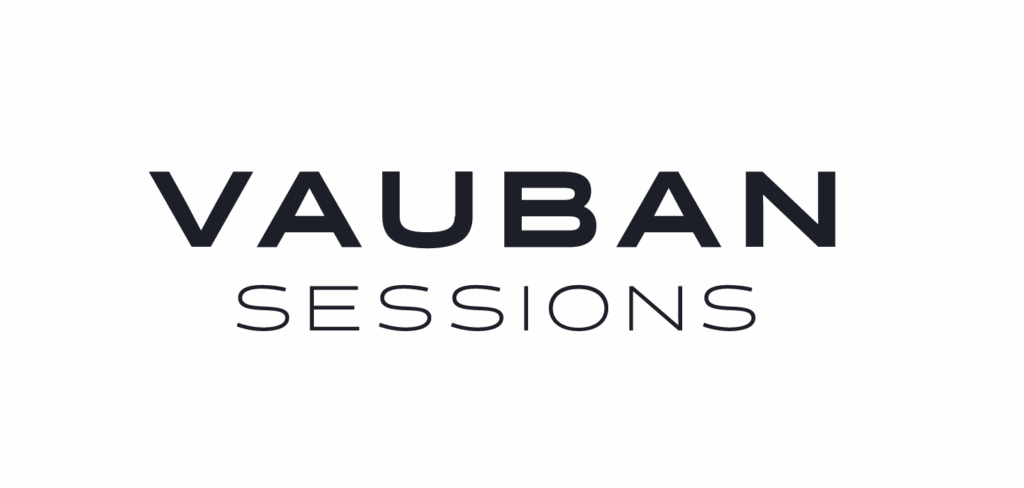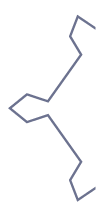L’édition 2025 des Vauban Sessions s’est déroulée dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de réémergence du risque de conflit de haute intensité en Europe. Des hauts responsables militaires de l’OTAN et de l’UE se sont réunis à Lille pour répondre au besoin urgent d’adapter les structures de Command & Control (C2), les concepts opérationnels et la planification stratégique à un environnement sécuritaire en mutation rapide. Le défi principal consistait à penser mieux, agir plus vite et frapper plus fort dans une époque qui exige à la fois résilience et innovation.
Les débats de cette année ont porté sur le renforcement de la résilience, non seulement au sein des
organisations militaires mais également dans l’ensemble de la société, en reconnaissant que l’efficacité
opérationnelle dépend aussi du degré de préparation des populations, de la capacité à régénérer les
forces et à soutenir des opérations prolongées. Les participants ont insisté sur la nécessité de
renforcer la génération de forces en coalition, d’améliorer la logistique et d’adapter les capacités
industrielles de défense aux réalités de la guerre moderne. Les sessions ont aussi mis en lumière les
obstacles persistants — des infrastructures à la réglementation en passant par l’interopérabilité et le
partage d’information — qu’il reste à surmonter pour garantir une dissuasion et une défense crédibles
à grande échelle.
L’intégration de technologies numériques avancées — systèmes de commandement de mission, intelligence artificielle, plateformes sans pilote — a été identifiée comme un levier essentiel pour disposer d’un C2 agile et efficace. Les intervenants ont toutefois rappelé que ces technologies doivent s’accompagner d’un leadership fort, d’une capacité d’adaptation et de partenariats civilo-militaires renforcés.
Les conclusions et enseignements tirés à la Citadelle Vauban témoignent d’un engagement collectif à accélérer la transformation des structures de défense alliées pour garantir leur préparation et leur capacité de résilience dans un contexte d’incertitude durable.
Renforcer la résilience et la préparation
L’un des thèmes centraux de la conférence était l’urgence de renforcer la résilience stratégique à tous
les niveaux : des soldats aux sociétés et institutions. La résilience n’est pas qu’une question technique
ou organisationnelle ; c’est avant tout un défi sociétal et psychologique. Après des décennies de paix,
les sociétés européennes doivent aujourd’hui se réadapter mentalement et matériellement à l’hypothèse d’un conflit de grande ampleur. Résilience individuelle et collective sont étroitement liées :
la préparation de chacun donne aux structures collectives le temps de réagir, tandis que la résilience
sociétale soutient l’endurance des opérations militaires. Cette approche doit être pensée comme une
série de cercles concentriques, partant de l’individu et s’étendant aux échelons local, national et
international. Elle seule permettra d’absorber les chocs, de s’adapter aux situations imprévues et de se
relever rapidement après les revers.
Un autre point essentiel a été de bien distinguer résilience et préparation. Là où la préparation vise à
établir des plans pour des scénarios identifiés, la résilience concerne la capacité à réagir et à s’ajuster
face à l’imprévu. La nécessité d’un changement d’état d’esprit a été largement soulignée, tant dans les
organisations militaires qu’au sein des sociétés, notamment pour préparer les populations aux
sacrifices et perturbations liés aux conflits de haute intensité. Il a également été question de revoir des
concepts comme la conscription ou le service national afin de répondre à l’attrition anticipée et de
maintenir le volume des forces disponibles.
Optimiser la génération et la projection des forces
La conférence a porté une attention particulière aux enjeux pratiques et stratégiques de la génération
et de la projection de forces dans un cadre multinational. Les enseignements des récents exercices et
du conflit en Ukraine ont servi de toile de fond aux réflexions. Si l’OTAN a progressé en matière de
planification et de préparation, la capacité à déployer et soutenir rapidement des forces importantes à
travers l’Europe reste freinée par des goulets d’étranglement en matière d’infrastructures, de
réglementation et de gouvernance.
Les infrastructures ont été identifiées comme un point de fragilité majeur. Malgré les investissements,
les réseaux de transport, ports et corridors essentiels au mouvement rapide des troupes et matériels
présentent encore des lacunes. Les obstacles administratifs et réglementaires, comme les délais de
notification pour les mouvements transfrontaliers, ralentissent encore la mobilité militaire, d’où l’appel
renouvelé à un « Schengen militaire » pour simplifier les procédures et réduire les frictions entre nations.
Les discussions ont également mis en évidence qu’au-delà de la planification descendante, la
constitution et le maintien en puissance des forces restent souvent insuffisants, notamment dans les
unités logistiques et de soutien. Un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’une approche
ascendante, fondée sur l’expérience et les besoins opérationnels des divisions et corps d’armée, pour
aligner les capacités nationales et mieux identifier des solutions réalistes en matière de maintien en
puissance et d’interopérabilité.
Le soutien de la nation hôte et l’intégration des ressources civiles dans la logistique militaire ont
également été soulignés. Face à l’ampleur des opérations envisagées, les forces armées devront
s’appuyer davantage sur les infrastructures et capacités civiles, ce qui implique de renforcer les
mécanismes de coordination à tous les niveaux. Enfin, la constitution et le maintien de stocks suffisants — notamment en munitions et pièces de rechange — ont été identifiés comme essentiels pour soutenir l’effort opérationnel dans la durée. Une politique industrielle de défense plus flexible et collaborative a été jugée indispensable, afin de permettre aux nations de diversifier leur production,
partager leurs technologies et lever les freins réglementaires pour pouvoir accélérer la production de
guerre en cas de besoin.
Faire progresser l’intégration technologique et l’adaptation opérationnelle
L’intégration des nouvelles technologies dans les structures de commandement et les concepts opérationnels a constitué un autre axe majeur des échanges. La transformation numérique n’a de sens que si elle renforce l’efficacité opérationnelle, la résilience et la rapidité décisionnelle. La généralisation des outils numériques, de l’intelligence artificielle et des systèmes sans pilote ouvre des perspectives considérables, mais génère aussi de nouvelles vulnérabilités, notamment en matière de cybersécurité, d’énergie et de connectivité.
Les postes de commandement devront désormais conjuguer modularité et exigence de survivabilité,
en réduisant leur empreinte physique et leur exposition tout en assurant le maintien de la connectivité
et de la connaissance de la situation. Les leçons tirées de l’Ukraine et d’autres théâtres récents rappellent l’importance de disperser les centres de commandement et d’utiliser des réseaux
numériques robustes pour permettre une reconfiguration rapide et assurer la continuité du
commandement en cas d’attaque.
L’intelligence artificielle est également appelée à jouer un rôle clé pour conserver un avantage
opérationnel. Elle peut accélérer les cycles de décision et optimiser les flux d’informations, mais son
intégration nécessite un calibrage rigoureux des besoins opérationnels et des garde-fous solides contre les usages inappropriés. Le principal défi reste de synchroniser innovation et réalités du terrain, dans un marché où la domination d’un nombre limité de grands industriels peut freiner l’émergence
d’innovations disruptives. Une évolution vers une innovation planifiée, itérative, fondée sur les retours
d’expérience et des cycles d’ingénierie courts a été préconisée.
Enfin, les facteurs humains, le leadership et la formation demeurent essentiels. Si la technologie
progresse, le succès opérationnel repose avant tout sur la qualité, l’adaptabilité et la résilience des
chefs et des soldats. L’intégration de nouvelles technologies doit aller de pair avec des standards de
formation actualisés, des exercices réalistes et une capacité à remettre en question les doctrines et
cultures organisationnelles établies.