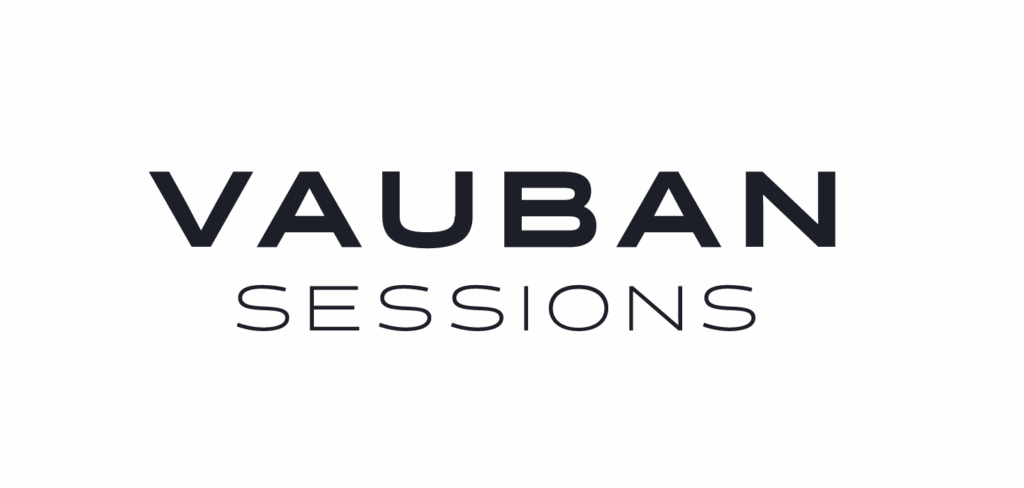20-21 Mai 2026
Les forces terrestres
à l’horizon 2045
Séminaire de réflexion prospective sur l’OTAN de haut niveau, les Vauban Sessions sont une initiative conjointe du Corps de réaction rapide – France (CRR-FR) et de la société Forward Global. Elles réunissent depuis 2019 de hauts responsables des forces armées de l’Alliance nord-atlantique afin d’échanger sur les perspectives des forces armées.
La 8ème édition des Vauban Sessions se tiendra à Lille les 20 et 21 mai 2026, en présence et sous le haut patronage du chef d’état-major de l’Armée de terre (CEMAT).
Dans un contexte stratégique euro-atlantique marqué par le retour des conflits de haute intensité, la fragmentation du système politico-diplomatique international et l’essor des technologies de rupture, il est crucial de réfléchir dès maintenant aux évolutions nécessaires des forces terrestres à l’horizon 2045.
Lors des sessions plénières et des ateliers parallèles, les participants exploreront les évolutions doctrinales, capacitaires, humaines et budgétaires qui façonneront les armées de terre de demain.
L’objectif sera de dégager des axes de transformation réalistes et cohérents pour garantir, sur le long terme, l’efficacité, la résilience et l’interopérabilité des forces terrestres dans un environnement multi-domaines de plus en plus contesté.
PREMIER JOUR
par le Général de Corps d’Armée Benoît Desmeulles, Commandant du Corps de Réaction Rapide France (CRR-Fr)
En 2045, les forces terrestres de l’OTAN seront confrontées à un environnement géostratégique profondément transformé, marqué par la compétition entre grandes puissances, l’évolution des menaces hybrides, et l’impact croissant des technologies de rupture. Comment anticiper au mieux ces transformations de l’environnement stratégique à long terme ? Quels seront les nouveaux théâtres d’opérations auxquels se préparer ou sur lesquels agir et quels en seront les enjeux ? Cette première session explorera les grandes lignes de la prospective géopolitique et militaire à l’horizon 2045 et ses conséquences sur le rôle et la configuration des forces terrestres de l’OTAN.
La montée en puissance du combat multi-domaines – intégrant espace, cyber, informationnel et robotique – appelle une redéfinition des moyens des forces terrestres. Comment celles-ci peuvent-elles conserver leur pertinence stratégique dans une posture de dissuasion renforcée ? Quelle articulation entre masse, agilité et interopérabilité ? Enfin, dans un contexte budgétaire contraint et dominé par la technologie, comment garantir l’efficacité opérationnelle des armées de terre ? Quel arbitrage entre innovation technologique, préparation du combattant et résilience des forces ? Autant de questions qui alimenteront le débat sur l’avenir de la puissance terrestre au sein de l’Alliance.
- Atelier 1 - Nouvelles dynamiques du combat aéroterrestre
Cette session s’appuiera largement sur les enseignements du conflit en Ukraine et des autres conflits actuels pour questionner l’évolution des modes d’action. La généralisation des drones, la perte de la maîtrise de l’espace aérien à très basse altitude, la multiplication des capteurs, la coordination étroite entre feux et manœuvre, ainsi que la mise en œuvre d’un commandement distribué ont profondément bouleversé le champ de bataille. Quels enseignements concrets tirer de ces évolutions tactiques et technologiques ? Comment adapter les pratiques et doctrines à cette réalité opérationnelle ? L’intégration des effets multi-domaines devient une nécessité, mais jusqu’où faut-il aller dans cette intégration pour préserver la réactivité et la cohérence du combat aéroterrestre ?
Par ailleurs, le paradigme du champ de bataille connaît une transformation radicale : la détection permanente, la raréfaction des zones sanctuaires due à l’action de plus en plus dans la profondeur de l’artillerie et des drones et l’érosion de la supériorité par la masse obligent à repenser l’engagement dans la profondeur. Comment concevoir des opérations efficaces dans un environnement saturé d’informations et de menaces ? La doctrine actuelle de l’OTAN permet-elle encore de répondre à cette nouvelle densité du champ de bataille ? Cet atelier apportera une réflexion critique sur l’adaptation nécessaire de la pensée aéroterrestre de l’OTAN pour faire face aux réalités émergentes des conflits modernes.
- Atelier 2 - Évolutions du Corps d’Armée à l’horizon 2045
À l’horizon 2045, le corps d’armée devra-t-il se réinventer pour rester pertinent dans un environnement de conflictualité marqué par la complexité, la simultanéité et la haute létalité ? Il reste plus que jamais un échelon clé de la synthèse entre la stratégie politique et la manœuvre opérationnelle. Comment redéfinir ses missions et ses capacités face à la montée en puissance du combat multi-domaines ? Quelles architectures de commandement permettront de conjuguer agilité, robustesse et résilience dans des opérations d’ampleur ? Cet atelier invitera une réflexion sur le rôle central du corps d’armée dans la conduite de manœuvres interarmées face à des adversaires technologiquement avancés et capables d’agir sur l’ensemble des milieux.
Dans un contexte de crises simultanées, hybrides ou prolongées, le commandement de théâtre sera soumis à des exigences accrues de coordination, de réactivité et de prise de décision. L’objectif est clair : (re)faire du corps d’armée un véritable « pivot opérationnel », capable d’orchestrer la complexité et de transformer l’information en action décisive.
Dans ces conditions, comment adapter le C2 du corps d’armée pour conserver l’initiative et garantir la cohérence des effets dans la profondeur ? Quelles synergies interarmées privilégier pour optimiser l’intégration des capacités air-terre, cyber, spatiales et logistiques à ce niveau ?
- Atelier 3 - Capacités et budgets : vers quels arbitrages ?
Les capacités et les budgets sont des questions centrales pour l’avenir des forces terrestres : comment trouver le juste équilibre entre masse, technologie et viabilité financière ? Quels arbitrages face à ce nouveau dilemme capacitaire ? Comment concilier innovation technologique et maintien d’une force suffisante en volume pour répondre aux menaces futures ? Se pose également la question des rythmes et formats de modernisation, afin d’adapter les trajectoires d’évolution des forces aux contraintes budgétaires sans compromettre leur efficacité opérationnelle.
Par ailleurs, la dimension stratégique du financement soulève un enjeu majeur : faut-il privilégier la coopération et la mutualisation des ressources au sein de l’OTAN pour optimiser les coûts et les capacités ? Comment organiser et piloter ces arbitrages complexes pour garantir la pérennité et la compétitivité des forces terrestres dans un contexte économique incertain ? Cet atelier visera à identifier des solutions innovantes et pragmatiques pour relever ces défis cruciaux.
DEUXIÈME JOUR
- Atelier 4 - Le soldat de 2045 : augmenté ou remplacé ?
À l’horizon 2045, au vu des évolutions actuelles, le soldat sera confronté à une complexité opérationnelle marquée par une charge informationnelle de plus en plus importante sollicitant de plus en plus ses capacités cognitives ce qui risque d’entrainer une fatigue décisionnelle. Comment préserver la lucidité et la performance humaine face à des flux d’information massifs et en temps réel ? Le tout dans un environnement de combat de plus en plus stressant et dans lequel le danger ne vient pas que de la direction de l’ennemi mais peut provenir de n’importe quel axe, entraînant une hypervigilance. Quelles sont les marges d’adaptation du combattant dans un environnement où la pression cognitive devient un facteur critique ? Les technologies émergentes – intelligences artificielles tactiques, interfaces cerveau-machine, assistants numériques – proposent des solutions pour alléger la charge mentale et accélérer le cycle de décision.
L’augmentation physique et sensorielle du soldat devient un enjeu stratégique : drones personnels, exosquelettes, systèmes de connectivité avancée transforment la posture, la mobilité et la perception du combattant. Cela pose des questions fondamentales de cybersécurité dans un contexte de guerre électronique. En outre, jusqu’où aller dans cette augmentation sans altérer le lien opérationnel entre l’homme et la mission ? Quel équilibre trouver entre automatisation et présence humaine dans l’action ? Le soldat de 2045 sera-t-il encore un acteur central du combat ou un opérateur au service de systèmes intelligents ?
- Atelier 5 - Interopérabilité : vers une convergence réelle ?
L’interopérabilité reste un pilier de l’efficacité des forces de l’OTAN, mais les écarts technologiques, doctrinaux et culturels persistent malgré les efforts de convergence. Les capacités numériques – qu’il s’agisse de commandement et contrôle (C2), de systèmes ISR ou de cybersécurité – posent des défis majeurs : comment garantir la compatibilité technique et la résilience des réseaux dans un environnement multinational et contesté ? Jusqu’où pousser l’harmonisation sans compromettre la souveraineté des outils nationaux ?
Les divergences capacitaires ou doctrinales, illustrées par des cas concrets d’incompatibilité sur le terrain, soulignent les limites d’une interopérabilité de façade. Quels enseignements tirer des retours d’expérience récents ? À cela s’ajoutent les enjeux humains : barrières linguistiques, différences culturelles et variations doctrinales peuvent freiner la fluidité des opérations conjointes. La convergence interopérable est-elle réellement atteignable, ou faut-il repenser son ambition ? Quelle part accorder à la standardisation, et quelle place laisser à la flexibilité ? Autant de questions essentielles pour faire de l’interopérabilité un levier opérationnel, et non un frein.
- Atelier 6 - Combat urbain & guerre hybride en 2045
Les environnements urbains sont des centres de gravité stratégiques, mêlant densité humaine, connectivité technologique et complexité tactique. Toutefois, les bombes guidées et les drones les rendent de plus en plus difficiles à tenir statiquement. Comment opérer efficacement dans des villes devenues à la fois terrains de manœuvre, espaces piégés et champs de bataille cognitifs ? Quels effets rechercher dans un espace saturé de capteurs, d’obstacles physiques et d’enjeux symboliques ?
La montée en puissance de la robotique urbaine, des capteurs autonomes et de la perception augmentée redéfinit les conditions d’engagement en zone bâtie. Comment articuler la technologie avec les savoir-faire tactiques sans accroître la vulnérabilité des forces ? Jusqu’où peut-on déléguer la perception et la décision à des systèmes automatisés ? La guerre hybride mêle actions informationnelles, soft power et létalité ciblée. Comment contrôler l’image du conflit dans un espace urbain, sans sombrer dans la propagande ? Quelle posture adopter pour conserver l’ascendant tactique et « narratif » dans des environnements où chaque action est visible, interprétée, et potentiellement retournée contre soi ?
Les forces terrestres font face à une intensification de la conflictualité et à l’émergence de formes de coercition inédites, fondées sur l’autonomisation croissante du champ de bataille. Comment anticiper ces ruptures stratégiques et technologiques pour ne pas les subir ? Quels scénarios de transformation prendre en compte dans la planification capacitaire et doctrinale ? L’enjeu est de tracer une trajectoire claire et cohérente face à un spectre d’engagements allant des conflits de haute intensité aux crises hybrides ou prolongées.
Entre exigences opérationnelles, contraintes budgétaires et pression technologique, il s’agit de construire une feuille de route réaliste et durable. Quel équilibre viser entre préparation au choc majeur et capacité d’endurance dans la durée ? Comment préserver l’agilité stratégique sans sacrifier la résilience ? Enfin, dans un environnement où la technologie ne peut tout compenser, le facteur humain reste central. Comment faire du moral des troupes, de l’adhésion des sociétés et de l’engagement des nations un véritable pilier stratégique ? Quelle vision partagée pour garantir la légitimité et la cohésion de l’action militaire de l’OTAN à long terme ?
Pour plus d’information, veuillez contacter :